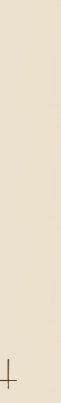Photogrammétrie
Historique de la
Photogrammétrie
Architecturale
La Photogrammétrie et le Relevé de l'Architecture (2)
Évolution depuis 1919
Jusqu'en 1934, les deux méthodes exposées plus haut restent en conflit. Les méthodes d'intersection
graphique appliquées
unanimement jusqu'ici ont encore de grands défenseurs comme Henri Deneux
(Architecte en chef des Monuments Historiques
Français) qui publie en 1930 un ouvrage intitulé "La
Métrophotographie appliquée à l'Architecture". Lors du congrès de Paris en
1934, la discussion est encore
âpre entre les partisans des deux méthodes et chacun reste sur ses positions : la Commission
Architecture
du Congrès présenta malgré tout des résolutions comme celle d'établir les archives photogrammétriques
dans tous
les pays d'Europe et d'enseigner la photogrammétrie dans les écoles d'architecture.
Dès lors, les partisans de Laussedat se perdent peu à peu et seul le Messbildanstalt de Berlin conserva cette
méthode
jusqu'en 1945. En 1935 un article qui vente les multiples procédés de la stéréophotogrammétrie
aussi bien pour l'architecture
que pour la sculpture entraîne le développement de ces travaux en Allemagne,
Tchécoslovaquie et Suisse. En France, l'IGN
effectue en 1943 son premier travail stéréophotogrammétrique
d'architecture sur la Sainte Chapelle de Paris : cet essai donne
toute garantie sur la qualité et la précision des
résultats. Dans le même temps, les Pays-Bas constituent des archives
photogrammétriques de ses principaux
monuments.
Après 1945, les procédés utilisant des constructions graphiques sont définitivement abandonnés. Quelques
années plus tard,
les possibilités accrues de la photogrammétrie analytique viennent s'ajouter à celles du
redressement et de la stéréorestitution.
À partir de 1960, les évolutions sont essentiellement d'ordre technique (cf. avancées techniques).